 |
||
Newsletter de Khalifa CHATERAnalyses géopolitiques : 1 aout 2020
|
||
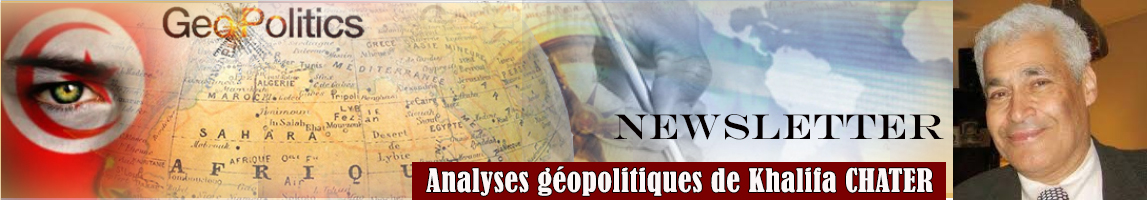 |
||
Chère/cher abonné(e) Visiteur,Vous trouverez dans ce numéro les dernières publications intégrées à mon site personnel [www.khalifa-chater.com]
|
||
RUBRIQUES
|
||
|
|
||
|
LE BILLET DU MOIS |
||
LA tragédie de Beyrouth
“Beyrouth [...] où l’on vient de partout ériger ces statues À Beyrouth chaque idée habite une maison. Qu’elle soit religieuse, ou qu’elle soit sorcière,
Nadia TUENI (1935-1983)
Cet hymne à Beyrouth mérite d’être rappelé, alors qu’elle a subi, ce 4 août 2020, une double explosion meurtrière. Le bilan, encore provisoire, faisait état, jeudi 6 aout, d’au moins 137 morts et de plus de 5 000 blessés. Aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes se retrouvent à la rue. L'heure est aussi à la recherche des coupables de la tragédie. Le Liban est encore sous le choc et la communauté internationale mobilisée. L’explosion s’inscrit dans un contexte de contestation populaire et d’une grave crise économique, dans l’ère appelée diplomatiquement “printemps’’ arabe.
Comment expliquer cette double explosion meurtrière de Beyrouth ? Qui en sont les responsables ? Dans les heures qui ont suivi, l’explosion a été attribuée à la présence de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium stockées depuis 2014 dans un entrepôt du port “sans mesure de précaution”, et ce, malgré les alertes des services douaniers. Peut-on parler d’interventions extérieures ou plutôt expliquer l’explosion par un certain laisser aller général, conforté par l’affaiblissement des pouvoirs centraux, de la contestation populaire, du contexte du “printemps’’ arabe, qui a mis à l’ordre un relâchement général, dans un Moyen-Orient qui nécessite un redressement global ?
|
||
| ÉTUDES INTERNATIONALES |
||
|
Le post-printemps arabe
Des hirak, des contestations populaires plutôt que de vraies révolutions, ont remis en cause les régimes autoritaires de l’aire arabe. Les résultats obtenus dépendaient, dans une large mesure des spécificités des Etats. Des présidences à vie, des régimes de partis-états définissaient ces cas de despotisme plus ou moins éclairées ou prétendus tels : En Egypte et en Libye, le pouvoir avait une caractéristique militaire, dépendant de sa genèse. Alors que l’Egypte est centralisée, la Libye maintenait de fait ses divergences régionales et tribales. En Syrie, le pouvoir d’Assad s’appuyait sur le parti Baath. En Algérie, le pouvoir conciliait l’autorité de la direction du FLN et de son soutien, par l’armée. En Tunisie, le pouvoir était le produit du coup d’Etat de 1987, qui a écarté le leader Habib Bourguiba. Au Yémen, la guerre civile divise le pays, en deux mouvances, en 1962 et suscite une guerre de procuration entre l’Egypte et l’Arabie. En dépit de la fusion, en 1990, de la République arabe du Yémen (Yémen du Nord) et la République démocratique populaire du Yémen (Yémen du Sud), la centralisation reste aléatoire, vu le tribalisation dominant. Bien entendu, le jeu politique internationale et régionale affecta l’aire arabe et remis en cause sa stabilité.
|
||
|
Une crise de gouvernance
La gouvernance désigne la manière dont un gouvernement exerce son autorité économique, politique et administrative et gère les ressources d'un pays en vue de son développement. Elle a "pour but de fournir l'orientation stratégique, de s'assurer que les objectifs sont atteints, que les risques sont gérés comme il faut et que les ressources sont utilisées dans un esprit responsable". La révolution tunisienne avait comme objectif d’assurer une meilleure gouvernance, au service des citoyens, leur assurant la liberté, la dignité et l’amélioration de leurs niveaux de vie. Elle constitua un défi, pour tous les gouvernements qui se sont succédé. Fait évident, la bipolarité idéologique, les guerres entre partis et la compétition pour les charges ministérielles ont remis en cause la priorité du développement. L’endettement de l’Etat, le développement du chômage, la baisse du niveau de vie et la baisse du pouvoir d’achat ont été aggravés par l’inflation et la chute du dinar. La pandémie accrut le chômage et bloqua les moyens d’intervention de l’Etat, au service de la société. Une décroissance de moins de 7 % devait annihiler toutes possibilités de redressement.
|
||
| ARTICLES EN LIGNE | ||
|
|
||
|
|
Bonne lecture |
|
